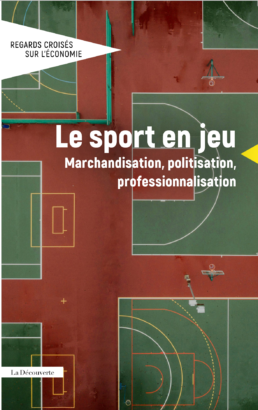Après l’échec de ses différentes candidatures depuis 1924, la ville de Paris a organisé à l’été 2024 les Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Loin de se cantonner à une compétition sportive, cet événement planétaire organisé tous les quatre ans rappelle les retombées économiques immenses du sport-spectacle. En captant un public de plusieurs milliards de personnes, les JOP génèrent en effet des revenus importants, provenant tant des droits de diffusion que du sponsoring ou des ventes de produits dérivés. Pour les dernières éditions des JOP, les recettes économiques se situent ainsi en moyenne entre 6,7 et 11,1 milliards d’euros . L’emploi se trouve lui aussi affecté puisque la construction d’infrastructures sportives pour les JOP de 2024 aurait à elle seule nécessité près de 26 millions d’heures de travail selon l’Insee . Derrière ces résultats économiques spectaculaires se cache cependant une réalité parfois moins reluisante. Aux JOP de Rio de 2016, l’Agence nationale du sport avait ainsi révélé que 40 % des sportif·ve·s français·e·s vivaient sous le seuil de pauvreté, la plupart des sportif·ve·s de haut niveau concourant aux Jeux olympiques n’ayant pas le statut professionnel. Si les aides financières destinées aux sportif·ve·s français·e·s de haut niveau ont été revues à la hausse depuis , ce constat est symptomatique des profondes inégalités socio-économiques qui caractérisent le monde du sport aujourd’hui où se côtoient des sportif·ve·s inégalement visibilisé·e·s et valorisé·e·s en fonction de leurs caractéristiques propres ou de la discipline qu’iels pratiquent.
L’économie du sport est toutefois loin de se limiter aux grandes compétitions sportives. Alors que le sport professionnel ne concerne que quelques milliers de personnes, près de 9 millions de licences sportives et autres titres de participation ont été délivrés en 2022 sur le territoire français. Plus encore, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) notait en 2022 que 72 % des Français·e·s avaient pratiqué une activité sportive au moins une fois au cours des derniers mois . Ces activités sont à l’origine de nombreuses dépenses qui façonnent un marché du sport-loisir. En France, depuis 2005, le ministère des Sports, en collaboration avec l’Injep, développe ainsi une approche pour estimer le poids économique du sport dans l’économie française, fondée sur les dépenses des ménages, les dépenses publiques et les dépenses des entreprises. D’abord, la dépense sportive des ménages, comprenant l’ensemble des dépenses nécessaires à la pratique du sport (souscription d’une licence, adhésion à un club de sport ou autres associations sportives, ainsi que les droits d’accès aux installations sportives privées ou publiques) et les dépenses liées à l’achat de billets pour assister aux manifestations sportives, représentent 0,8 point de Produit intérieur brut (PIB) en 2021. Par ailleurs, la prise en compte de la dépense sportive publique (0,6 % du PIB) et de la dépense sportive des entreprises (1,7 % du PIB, principalement appréciée par les droits de retransmission des événements sportifs et par le mécénat) élève la dépense sportive totale à 3 % du PIB. L’économie du sport, ainsi considérée, génère près de 40 milliards d’euros par an en France.
Cet encastrement croissant du sport dans la sphère marchande, qui semble aussi bien toucher son versant professionnel que son versant amateur, ne se fait cependant pas sans obstacle. D’un côté, l’organisation d’événements sportifs mondialisés fait l’objet de contestations croissantes au regard des dommages environnementaux irréversibles qu’elle occasionne, dus aussi bien à la construction d’infrastructures ex nihilo qu’aux flux massifs de biens et de personnes qu’elle engendre. La pratique sportive amateur génère, quant à elle, d’importantes externalités positives d’un point de vue sanitaire qui justifient une régulation étatique visant à garantir l’accessibilité du sport à tou·te·s dans un souci de santé publique. Enfin, le sport est aujourd’hui reconnu comme un vecteur majeur d’insertion et d’intégration sociale, ce qui en fait un service économique encastré dans des logiques et des organisations non marchandes.
Réunissant différentes contributions de chercheur·se·s en sciences sociales, ce nouveau numéro de Regards croisés sur l’économie entend précisément embrasser cette vision protéiforme de la marchandisation du sport en appréhendant l’économie du sport aussi bien sous sa dimension spectaculaire que sous sa dimension la plus ordinaire. Analysant la marchandisation du sport professionnel et ses conséquences, la première partie souligne la segmentation accrue d’un marché qui se caractérise par une distribution très inégale des ressources économiques entre les différentes disciplines et sportif·ve·s. Cette marchandisation du sport touche non seulement le sport professionnel mais aussi le sport amateur, comme le montrera la deuxième partie qui prend la perspective des amateur·ice·s de sport, mettant en lumière les implications sociales et économiques de la diffusion de la pratique sportive, que ce soit en tant que participant·e·s actif·ve·s ou spectateur·ice·s. La troisième partie montre cependant que ces logiques marchandes s’articulent à des logiques politiques en soulignant le rôle ambivalent du sport, à la fois vecteur de luttes sociales et instrument de pouvoir, tant au niveau local qu’international.
Les auteurs
1/ La fabrique sociale de la performance sportive par Manuel Schotté
2/De l’inégalité des revenus dans le sport professionnel par Antoine Feuillet
5/Facteurs socioéconomiques de l’inclusivité d’une pratique sportive par Jean-Pierre Garel
6/Sport de haut niveau : l’insécurité comme doctrine managériale par Sébastien Fleuriel
7/Le dopage sur un marché « Winner-Takes-All » par Jean-François Bourg
8/Accompagner la reconversion des sportifs de haut niveau par Sophie Javerlhiac
14/Entre normes et représentations : le genre du sport par Marie-Françoise Galy
15/Comment appréhender l’e-sport et quel droit lui appliquer ? par Emeline Guédès
Partie 3 : Le sport au-delà de l’économie : un enjeu politique
16/ L’alpinisme, un « quasi-sport » au service d’une élite sociale et masculine par Delphine Moraldo
19/ La piscine publique, les nageurs, le maire et le réchauffement climatique par Benoît Hachet
20/ Quel avenir pour les stations de sports d’hiver ? par Frédéric Balaguer
22/ Le sport au service de la stratégie d’influence des monarchies du Golfe par Pascal Gillon